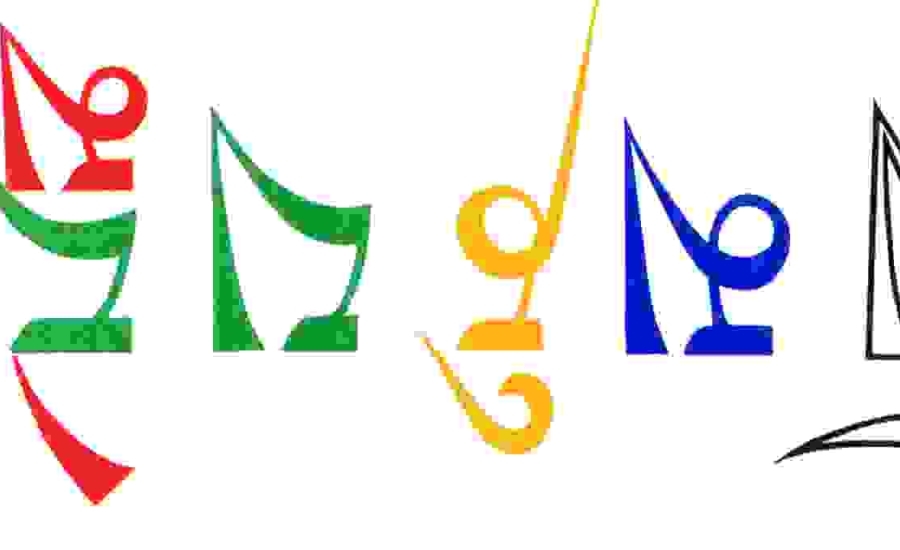LA GUERRE POUR LA DROGUE
«Il n’y a aucune raison de punir les gens qui consomment [de la drogue], s’ils ne nuisent pas aux autres.» C’est ce que déclarait
Ruth Dreifuss, ancienne présidente de la Confédération helvétique (1999), au «Carrefour des idées», organisé par Avenir Suisse, à Genève, en 2016. Ce combat pour la légalisation des drogues est loin d’être personnel. Il s’inscrit même dans un projet étonnamment élaboré dont Mme Dreyfus n’est qu’un éminent relais.
Ruth Dreifuss est, comme on le sait, la porte-parole en chef de George Soros en cette matière. Membre du conseil consultatif sur les questions de la drogue au sein de la fondation faîtière d’Open Society, elle est également présidente de la Global Commission on Drug Policy (GCDP), basée à Genève. Ce club d’anciens chefs d’État, ministres et secrétaires généraux de l’ONU, outre quelques milliardaires actifs, est financé par l’Open Society et le Département fédéral (suisse) des affaires étrangères.
Une preuve de plus que le gouvernement helvétique n’estime plus nécessaire de cacher son noyautage par les réseaux privés du Deep state américain.
Mme Dreifuss officie également au sein de la fondation britannique «Transform Drug Policy», qui est évidemment une autre entité de la galaxie Open Society. On l’y trouve aux côtés de quelques-uns des mêmes grands prêtres du sacerdoce sorosien que ceux de la GCDP, tels que **Barack Obama, Bill Clinton, John McCain, Kofi Annan, Sir Richard Branson, Bill Gates ** ou encore l’ancien numéro 2 du MI6 Nigel Inkster. Ce dernier est coauteur du très stupéfiant rapport Drugs, Insecurity and Failed States: The Problems of Prohibition. Et comme les liens de légitimation intellectuelle se font toujours au détour de supercheries endogamiques plutôt universitaires, l’autre coauteur dudit rapport, Virginia Comolli, une Mata Hari assumée de l’Intelligence Service, dispose également d’un poste à l’université de Swansea (Pays de Galles), au sein du Global Drug Policy Observatory (évidemment toujours financé par Open Society). Or, le jeune Khalid Tinasti, qui n’est autre que le secrétaire général de la GCDP précitée, dirigée par Dame Ruth, y opère également. «Joli monde», comme disait la chanson!
L’État, dealer n° 1?
En trois ONG et deux départements universitaires, on dessine déjà la matrice d’une authentique machine de guerre d’influence, déclinée en d’innombrables sous-structures, qu’il serait trop fastidieux d’inventorier ici, et où s’entrecroisent pêle-mêle les baronnies médiatiques, «non-gouvernementales», militaires, diplomatiques, religieuses, médicales, universitaires, commerciales ou encore bancaires du roi Soros Premier. Les mauvaises langues, comme celle du président hongrois Viktor Orbán, n’y voient pas de différence avec une organisation «mafieuse». Que diantre va-t-il chercher là! Comme le disait Dame Ruth dans une interview au journal Le Temps parue en 2015 et qui ne choqua personne: L’État doit juste «se substituer aux dealers». On ne saurait être plus clair. l’État doit produire lui-même et exporter, ou acheter et importer les «stupéfiants», ces poisons de la «stupeur», comme au bon vieux temps des guerres de l’Opium.
Car ce que Dame Ruth et son mentor de Soros veulent assurément, c’est nous refaire le coup des «traités inégaux» de Nankin (1842) et de Tianjin (1858), mais à l’échelle planétaire. C’est en effet à ce moment-là que l’économie des drogues s’imposa comme une pièce maîtresse du processus de mondialisation naissant, sachant depuis lors, qu’il ne saurait y avoir de mondialisation sans drogue. Alors, autant la contrôler comme au XIXe siècle.
La guerre de l’opium 2.0
Souvenons-nous: les importations de thé vers le Royaume-Uni, que la Chine était encore seule à produire, créèrent un déficit ruineux pour l’Empire britannique. Celui-ci répliqua par l’exportation, vers la Chine, d’opium illicite, cultivé principalement au Bengale, sous monopole de l’East India Company. La Chine importa rapidement plus d’opium qu’elle n’exportait de thé et comme ses échanges internationaux se payaient en Tael d’argent, à un cours qui se fixait déjà à Londres et New York, elle produisit une inflation qui l’obligea à interdire l’importation d’opium, quitte à le produire elle-même pour étancher la dépendance de son peuple.
Ceci conduisit les Anglais à obliger le «Fils du Ciel» à rouvrir son marché, par la force des canonnières.
L’opiomanie chinoise fut à la fois le premier phénomène d’addiction de masse de l’histoire humaine et la première intégration structurelle du marché de la drogue au succès annoncé d’une mondialisation de l’économie, garantie par la guerre.
À la fin du XIXe siècle, l’opium était passé du statut de produit thérapeutique à celui de produit commercial récréatif et permit de financer les coûteuses possessions coloniales de l’empire britannique. Avec la chute de la dynastie Qing, c’est encore l’opium qui permit à la jeune république de Chang Kai-shek de financer son installation depuis les aires de production du Yunnan en passant par l’Indochine française. Ces domaines furent ensuite transférés vers le fameux Triangle d’or au tournant des années 40. Le narcotrafic international était né comme instrument de puissance de l’État et ce que l’on comprend du discours sorosien, c’est qu’il est grand temps qu’il redevienne licite afin que tous les intérêts privés du globe puissent en tirer profit.
La justification thérapeutique a de quoi faire sourire dans ce contexte, lorsque l’on sait que toutes les guerres soutenues par Soros, de l’Afghanistan au Caucase en passant par les Balkans et les Printemps arabes, puisent dans le marché de la drogue pour se financer. Ce n’est pas son vieux complice Lord Mark Malloch-Brown qui le contredira. Il fut successivement administrateur du Soros Advisory Committee on Bosnia (1993-1994), vice-président de l’Open Society Institute et coprésident du Board of Trustee de la fondation faîtière, entre autres grâces et titres conférés par le roi Soros en personne. Or, en 2007, en sa qualité de ministre des Affaires étrangères du gouvernement Gordon Brown, le même préconisa tout simplement de légaliser le marché de l’opium afghan, estimé à l’époque à pas moins de 8200 tonnes, sur un modèle de subventions équivalent à celui de la Politique Agricole Commune européenne. Il offrait ainsi à l’OTAN d’acheter la drogue directement aux fermiers, à un prix certes plus élevé que celui imposé par les narcotrafiquants locaux, principalement pakistanais d’ailleurs, mais en s’assurant d’un monopole par les armes. En bref, il substituait les puissances étatiques et commerciales de l’OTAN aux dealers, selon la formule de Ruth Dreifuss.
De la société de consommation à la société d’addiction
Le grand absent de cet immense projet de captation d’héritage agricole et néanmoins psychoactif, c’est le drogué. En réduisant son état d’individu responsable à celui de malade qu’il faut soigner, Soros déguise à peine son objectif d’étendre la neutralisation du libre arbitre citoyen, déjà bien entamée. Le projet sorosien n’est autre que de parachever le passage de la société de consommation à la société d’addiction, dans un contexte général d’intensification des émotions psychostimulées et d’accélération des cadences de ces «récompenses» festives chimiquement assistées. Soros sait qu’on entre dans toute drogue sans effort et sans études, et que des millions de jeunes s’y installent justement sans jamais plus réussir à faire d’efforts ni d’études. Il sait que l’assuétude n’est autre que la manifestation d’un échec du contrôle de soi, qui laisse symétriquement la place au contrôle sur soi, exercé nécessairement par les vendeurs et les taxateurs de drogue, ses obligés.
Les enjeux économiques sont évidemment à la mesure de l’investissement d’influence. Pour la seule Amérique du Nord, le marché du cannabis licite a progressé de 34% en 2016, avec 6,7 milliards de dollars de ventes, et de 37% en 2017, avec 16 milliards de dollars. L’arrivée de la Californie dans le jeu, depuis le 1er janvier 2018, va évidemment faire exploser ce chiffre. A elle seule, elle représente un marché illicite estimé à plus de 13 milliards de dollars, dont la légalisation devrait absorber tout de suite 62 % selon les dernières études. D’ici 2021, le marché du cannabis licite devrait ainsi représenter 40 milliards de dollars aux États-Unis et créer plus de 410 000 emplois. Quant aux recettes fiscales, on les estime à pas moins de 4 milliards de dollars. Si on y ajoute la réduction drastique des coûts de police et justice, qui se chiffrent aujourd’hui autour des 27 milliards de dollars, on voit mal comment la légalisation n’envahirait pas tous les agendas législatifs américains à très court terme. Les européens suivront dans la foulée.
ANGLE MORT par Fernand Le Pic (DRONE 005 – du 11 Janvier 2018)
dmc